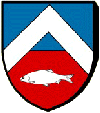29 septembre 1837 CONSTANTINE St ARNAUD - Suite 1
<ret>Revenir</ret>
Là, frère, j'eus ma première récompense, le colonel Combes me sera affectueusement la mainen me disant : Bravo, capitaine! J'étais tellement enthousiasmé que seul je me serais jeté sur des canons. L'explosion avait, dans son désastre, eu ce côté avantageux pour nous, qu'elle avait arrête les Turcs, et facilité l'entrée de la ville ; une porte, une voûte, et plusieurs maisons avaient sauté. - Environ cent hommes des nôtres, tant de zouaves due du 2è léger et compagnie franche, dormaient sous les décombres. Lamoricière blessé était emporté par ses zouaves.
Alors, frère, nous nous jetâmes dans la ville, chacun où le hasard et son instinct le poussa, les ordres étaient confus. C'était un chaos, mais un chaos dont les éléments étaient l'intrépidité et l'oubli de soi-même. - J'avais ordonné à mes hommes de ne jamais me dépasser, mais de me suivre toujours ; je commençai à me jeter dans la batterie à gauche de la brèche. Dans un petit carré servant de place à l'embrasure d'un canon, sept Turcs faisaient un feu continuel sur nous. Je m'élançai dans ce trou la tête baissée, mes hommes me suivaient de près. Les Turcs se défendaient avec le courage du désespoir. Ils faisaient feu et nous les tuions rechargeant leurs armes ; ce sont d'admirables soldats ; la baïonnette n'en laissa pas un vivant. On ne faisait pas de prisonniers.
En quittant la batterie, je me dirigeai sur le point où la fusillade me paraissait la plus vive. J'arrivai à la maison de Ben Aïssa, le lieutenant du bey. Le commandant Bedeau y était avec le commissaire commandant Despinois. On cherchait encore des issues pour pénétrer en avant dans la ville. Les balles nous pleuvaient de partout et tombaient sur les dalles autour de nous, comme de la grêle qui frappe sur les toits et les carreaux.
Je demandais des ordres, je sollicitais pour qu'on m'envoyât hors de cette cage, où je tournais comme un ours qui évite les frelons. Enfin le génie arrive en criant qu'il y a une barricade à enlever au bout d'une petite rue, et que cette issue donne dans une des rues principales. Je regarde le commandant Bedeau et sur un petit signe d'approbation, que moi seul je devine, je m'élance avec mon peloton, en criant : A moi la légion! Oh! cette petite rue étroite et sinueuse comme la Traversine d'autrefois, tu te rappelles, cette petite rue, je la verrai souvent dans mes rêves... Elle était encombrée de soldats. Les hommes du bataillon d'Afrique s'y pressaient avec les nôtres et pendant dix minutes au moins nous avons marché sur le cadavre du capitaine Hackette,du génie, tué là avant notre arrivée. Tout le monde criait, on ne s'entendait pas. Mon garde me donnait là de l'influence et du pouvoir : au milieu des balles je rétablis une espèce d'ordre, je fis enlever le corps piétiné de notre camarade, et m'avançant vers le bout de la rue, je vis que nous étions arrêtés par le feu formidable d'une barricade artistement construite : portes, poutres, matelas, rien n'y manquait. Les Kabyles la défendaient par le feu le mieux nourri et nous tuaient beaucoup de monde. Retourné à mes hommes, je leur fis comprendre qu'en allant à la barricade au pas de course et l'enlevant à la baïonnette, on perdrait beaucoup moins de monde qu'en tiraillant inutilement contre des matelas. Ceci bien compris, je plaçais dans les maisons voisines , conquises par nous, quelques tirailleurs adroits qui dominaient la barricade, incommodaient fort les défenseurs ; puis, le sabre à la main, aux cris de Hourra, mieux connu de mes soldats étrangers , aux vociférations de : en avant la légion, je me jettai sur la barricade que je franchis en tombant de l'autre côté au milieu des Arabes. Cette chute me sauva car toutes les balles me passèrent au dessus de la tête ; on me tira de si près que ma capote fut brûlée par la poudre, mon fourreau de sabre traversé d'une balle. Là, par terre, j'eus le bonheur d'entendre un soldat, crier furieux : Au capitaine, au capitaine, il est blessé, par terre, par terre. Ma chute les avait trompés . Debout comme l'éclair je commençai à travailler les Turcs comme il faut, et la barricade presqu'aussitôt détruite nous donna passage à gauche, dans cette même rue où les zouaves et la 1ère colonne avaient été d'abord repoussés. A droite était la brèche à environ trois cents pas.
Cette rue, frère, c'était la rue marchande de Constantine, garnie de chaque côté de boutiques sans étages qui les surmontent ; de loin en loin, quelques maisons occupées par les Turcs, les toits surmontant les boutiques, plats et garnis de Turcs, rue serpentante, à coudes arrondis, étroite comme la rue Saint-Jacques, quelques fois davantage.
C'était cette rue qu'il fallait prendre, maison par maison, et sous un feu d'autant plus terrible qu'on ne voyait pas d'où il venait. C'est dans cette rue où l'on marchait jusqu'aux genouc dans des cadavres et dans le sang, que nous avons perdu le plus de monde. C'est dans cette rue que le brave Combes a été blessé mortellement ; que Lacoste, mon pauvre sous-lieutenant, a été tué. Mais n'anticipons pas.
En entrant dans cette rue, mon premier soin fut d'établir mes hommes de chaque côté : ceux de droite tiraient sur tout ce qu'ils voyaient d'ennemis à gauche ; ceux de gauche faisaient feu à droite. Malgré cela, mes hommes tombaient et pour ne plus se relever, car toutes les blessures étaient mortelles : on tirait de trop près. - Après vingt pas nous fûmes arrêtés par un feu roulant et croisé qui détruisait tout ce qui voulait hasarder le passage. Le soldat n'obéissait plus d'élan à la voix de son chef... Cet obstacle nous venait d'une grande maison, à droite, à plusieurs étages, et qui semblait en feu tant elle nous envoyait de mitraillade dans des fusil de remparts, tromblons, etc. J'ai su depuis que c'était la caserne des soldats du bey. Il n'y avait qu'un parti à prendre, enlever la maison. En un instant, cinq ou six officiers de différents corps réunis rassemblent leurs soldats ; on enfonce la porte, on se précipite dans les cours, dans les escaliers, sur les terrasses, dans les chambres... Quelle scène, frère,quel carnage, le sang faisait nappe sur les marches... Pas un cri de plainte n'échappait aux mourants ; on donnait la mort ou on la recevait avec cette rage du désespoir qui serre les dents et renvoie les cris au fond de l'âme... Les Turcs cherchaient peu à se sauver, et ceux qui se retiraient profitaient de tous les accidents de murs pour faire feu sur nous... J'ai vu là bien d'autres morts, j'ai fixé bien de ces terribles et poétiques figures de mourants qui me rappelaient le beau tableau de la bataille d'Austerlitz.
La maison prise, n redscendit à la hâte trouver la rue le même feu à peu près qu'on y avait laissé. Les Turcs s'étaient embusqués dans un coude et de là nous décimaient. C'est là, qu'à côté de moi, se promenant tranquillement au milieu de la rue, encourageant tout le monde de l'exemple, du geste et de la voix, l'intrépide Combes fut atteint d'une balle... Un simple mouvement nerveux accusa la souffrance ; il se retourna du côté de la brèche et reçut une seconde balle qui amena le même mouvement, sans une plainte, sans un mot ; il continua à marcher vers la brèche, la descendit seul, traversa l'esplanade jusqu'à la batterie de 24, où étaient réunis le prince, le général Valée et tout son état-major. On s'aperçut qu'il était blessé et le prince lui en témoignait ses regrets...
Combes répondit par un rapport clair et succint de ce qui se passait à sa colonne, et termina en disant : Monseigneur, ceux qui seront assez heureux pour revenir de cet assaut là, pourront dire qu'ils ont vu une belle et glorieuse journée. Et s'adressant au chirurgien major de l'artillerie, il lui dit : Docteur, j'ai de la besogne pour vous. Le lendemain la France perdait une des espérances de son armée, un intrépide guerrier, aussi froid au feu que sage dans le conseil... Moi, je pleurais un ami, car nous nous étions serré la main deux fois, dans des circonstances que des coeurs généreux n'oublient jamais... Une minute avant sa blessure je lui disais : Mon colonel, ne vous promenez pas là, il y fait trop chaud, il faut que nous allions en avant à tout prix, la position n'est pas tenable... Et il regardait comment on perdait le moins de monde.
Ce fut quelques instants après que je fus assailli par le Turc dont je t'ai envoyé le poignard yatagan. Il se jeta sur moi le sabre haut, son pistolet avait raté. Je n'eus que le temps de me précipiter sur lui en parant son coup ; ma lame lui pénétra dans le col... Un soldat de ma compagnie nommé Keller, qui était derrière moi , se jeta à ma droite et lui plongea sa baïonnette dans le corps ; au même instant il fut frappé lui-même de deux balles, une à la tête, l'autre à la poitrine ; le pauvre garçon mourrait pour moi, car ces balles m'étaient destinées, la troisème frappa dans mon manteau que je portais en bandoulière, ainsi que tous les officiers de la légion. Le Turc tomba, percé de vingt coups de baïonnettes, car chaque soldat lui lançait son coup. - Je pris le sabre qui m'avait menacé. - En roulant dans la boue, l'oeil fixe de cet homme me regardait encore avec une expression terrible.Tout le temps que les cadavres restèrent dans les rues, on s'arrêtait involontairement devant celui-là, qu'on admirait comme un type d'expression militaire, de colère et de menace. C'est aussi à quelques pas de là que le pauvre Lacoste fut frappé d'une balle à la tête. Pas un mot, pas une plainte ne s'exhala avec son dernier soupir ; il tomba à genoux comme pour prier et ne se releva plus du lit de boue qui venait de le recevoir.
A ce moment, frère, nous avançions lentement, le feu redoublait et la position devenait de plus en plus dangereuse ; en vain, plusieurs fois, j'avais voulu enlever mes hommes aux cris de : En avant ! Des balles les arrêtaient court et pour jamais... C'est là que le courage du sergent-major Doze et du sergent Piétri, leur mérita la croix que je leur ai fait obtenir ; je leur devais bien cela, car j'avais joué leur vie ; il est vrai que la mienne était aussi dans l'enjeu.
Voyant que le feu partant d'un point de la rue nous abattait tout ce qui se présentait à droite, j'allai placer moi-même Doze et Pietri en face de ce feu pour y riposter d'une manière sûre. Ces deux braves tirèrent plusieurs coups de fusil, dans le poste le plus périlleux. Je ne pouvais y rester avec eux, car je n'avais pas de fusil. Il me fallait, d'ailleurs, surveiller l'ensemble de l'attaque. Doze et Piétri échappèrent par miracle, je puis le dire. Je les présentai tous deux au commandant Bedeau, en racontant le fait, et j'eus le bonheur de voir sur leur poitrine une croix qui triplait la valeur de la mienne.
Je suis arrivé, frère, à l'instant de l'assaut où je crois avoir couru le plus grand danger. Des hommes tombaient dans cette mare de boue et de sang dans laquelle nous pataugions. Je pouvais prévoir, à quelques minutes près, le moment où j'irais moi aussi m'étendre dans cette fange noire qui me répugnait. Alors, frère, ta pensée est venue à mon coeur, comme un éclair, j'ai envisagé ta douleur ajoutée à d'autres douleurs déjà si poignantes... J'ai serré la poignée de mon sabre et je me suis dit, je ne mourrai pas... Nous étions arrêtés, on n'avançait plus, six du bataillon d'Afrique me séparaient du feu des Kabyles je prends une résolution, je me retourne vers mes soldats et je leur crie : "Vous serez tous tués là, suivez-moi, en avant, et je vous sauve." Aussitôt je les entraîne, nous chargeons les Turcs qui ne tinrent que peu, et la rue est balayée... Il était temps, pendant que je parlais à mes soldats, les six hommes qui étaient devant moi, avaient disparus dans la boue, et pour courir aux Turcs j'ai été obligé de sauter par dessus leurs cadavres.
De la même manière et chassant toujours les Turcs qui se défendaient pied à pied, nous parcourûmes plusieurs rues, entrant dans les maisons desquelles partait le feu le plus nourri. Dans une d'elles, une pauvre femme blessée à la tête d'un coup de baïonnette et une négresse vinrent se jeter à mes pieds : je les rassurai et les fis entrer dans une chambre où était un vieillard qui semblait attendre la mort. Je mis une sauvegarde à leur porte. Enfin frère, j'arrivai à une petite place où je rencontrai le commandant Bedeau que j'avais perdu de vue depuis la maison Ben Aïssa. Heureux de nous retrouver en vie, nous nous serrâmes la main. Il me fit quelques compliments en me voyant avec mon sabre et mon yatagan turc, et la figure et les mains pleines de sang, mon sabre rouge ; enfin moi j'avais l'air un peu boucher. A ce sang qui n'avait rien de moi, j'avoue que je n'aurais pas été fâché d'y voir mêlé un peu du mien. J'aurais désiré une blessure qui m'eût permis, cependant, de te revoir et de t'embrasser un jour. Une autre fois je serai plus heureux.
Sur cette petite place où venaient aboutir trois rues et où s'élevait une mosquée, nous eûmes encore des coups de fusil, mais ce n'était rien en comparaison de ce qui s'était passé.Le colonel Corbin, commandant le 17ème léger, qui avait remplacé le pauvre Combes dans son commandement, était là avec notre commandant. Je poussais en avant dans une rue, mais je fus tout de suite rappelé. Un Arabe, s'étant présenté avec un papier à la main, cria : Carta, Carta... Cet homme était le fils du Ccheik,tout était fini, la ville se rendait... Sur bien des points encore la fusillade continuait, mais aussitôt que l'on sût que la ville se rendait à discrétion. Les Arabes coururent en tous sens en criant : Semi, Semi, pour faire cesser le feu.
Ce mot semi, dont nos oreilles furent fatiguées si longtemps, n'est pas arabe : c'est une corruption du mot italien et espagnol insième, qui veut dire ensemble. Les arabes s'en servaient comme du seul mot qu'ils supposassent pouvoir être compris de nous, et nous présenter l'idée de la paix.
A peine le fils du cheick eut-il fait voir son papier qu'il élevait au dessus de la tête, et qui n'était autre qu'une lettres des habitants au général Valée pour rendre Constantine à discrétion, que les Arabes, mais surtout les Juifs, vinrent à nous, prenant nos mains, nos habits, les baisant, se prosternant, cherchant à lire dans nos regards. Un froncement de sourcils, une expression de colère les faisait fuir ou tomber à terre. Cela me dégoûtait.
Pour moi, poussé par mon esprit aventureux, je m'engageais dans cette ville inconnue, suivi d'une douzaine de soldats de différents corps. C'était une imprudence bien grande, car dans les rues où je pénétrais, on n'avait pas encore vu de soldats français. Nous n'avions pas pris un vingtième de la ville quand elle s'est rendue. Je me servais du peu d'arabe que je sais, et me faisais précéder de deux maures et un juif, criaient : semi, semi, je m'avançai vers la porte d'El-Countra (le pont), côté entièrement opposé à celui par lequel nous étions entrés. Cette porte fait face à la Mansoura, où était le général Trézel et sa division, et je voulais m'emparer de ce point important et livrer passage aux troupes françaises.
Dans ma route je passai devant la grande mosquée où je plaçais un poste de huit hommes. Je n'avais plus avec moi qu'un fourrier décoré du 47ème et un grenadier ; c'est avec ces deux hommes que je passai au travers d'une foule d'Arabes de tout sexe et de tout âge, fuyant d'abord à la vue de l'uniforme, mais s'approchant et s'encourageant à ce cri de Semi, sémi, que ni moi ni mes conducteurs n'épargnions. Là j'ai pu juger de la population nombreuse que nous aurions eu à combattre si la guerre avait duré.Tous ces Arabes se jetaient devant moi, prenaient le bas de ma capote pour la baiser et se dépouillaient de leur burnous pour me l'offrir ; mon refus de les dépouiller les remplissait d'un étonnement mêlé de joie où je trouvais une douce satisfaction.
C'est ainsi que je parvins à la porte d'El-Countra. Elle était tellement barricadée avec des poutres énormes et d'aussi énormes pierres de taille, qu'il ne fallait pas songer à la débarrasser. Il aurait fallu une journée et deux cents hommes de corvée. Je me contentai de crier du rempart aux français qui couronnaient les hauteurs de l'autre côté du pont et du ravin, que la ville s'était rendue et qu'on eût à envoyer des troupes occuper le pont et la partie extérieure.
Je laissai le fourrier et le grenadier dans le poste abandonné par les Turcs.
Depuis, ce fourrier, déjà décoré à Oran, est venu me faire signer un papier relatant les faits ci-dessus ; il a été nommé officier. Le grenadier est décoré, ; moi, je n'ai parlé de cela qu'au commandant Bedeau et après avoir reçu ma croix.
Les mêmes Arabes qui m'avaient conduit me ramenèrent seul à travers la foule, toujours accrue pour la cessation du feu, jusqu'à la Casbah où je voulais aller. Pour y parvenir il fallait traverser la ville dans toute sa longueur, et pendant tout ce trajet seulement quelques coups de fusil me furent tirés par des Arabes ignorant le traité, effrayés de me voir parmi eux. Ils se sauvaient de suite et la population elle-même se chargeait ou de les punir, ou de les arrêter. J'en battis un seul à grands coups de plat de sabre, parce que sa balle m'avait passé bien près du visage.
A la Casbah, un autre spectacle m'attendait... Les détachements armés des différentes colonnes commençaient à y arriver... Mais le pillage aussi avait commencé et expliquait comment si peu de soldat se trouvaient à la Casbah. Le général Rulhières y arriva vers midi ; il criait beaucoup après les pillards, menaçait de prendre les mesures les plus sévères, mais rien n'arrêtait le soldat ; il était victorieux, il avait beaucoup souffert, il avait acheté sa conquête au prix de son sang, il y aurait eu follie à vouloir l'arrêter. Le pillage, exercé d'abord par les soldats, s'étendit ensuite aux officiers, et quand on évacua Constantine, il s'est trouvé, comme toujours que la part la plus riche et la plus abondante était échue à la tête de l'armée et aux officiers de létat-major...
Je ne m'appesantirai pas d'avantage sur ces scènes de pillage et de désordre ; elles ont duré trois jours. Jetons un voile épais et ne ternissons pas notre gloire et nos souvenirs. Dans toutes les maisons le pillage était facile, car elles étaient la confiance des habitants dans la force de leur ville et de leurs défenseurs, et ils croyaient si peu à la prise, que partout on a trouvé le couscous au feu et le café prêt.
Du côté de la Casbah, côté opposé,à celui par lequel nous étions entrés, un spectacle affreux s'offrait à nos yeux : environ deux cents femmes ou enfants gisaient brisés dur les rochers qui ferment la ville sur cette face. Les Arabes nous voyant gagner du terrain dans la ville, et commençant à croire à leur défaite, étaient venus essayer de sauver leurs femmes et leurs enfants, et ils avaient tenté, par ces ravins impraticables, une fuite impossible. La terreur, précipitant leurs pas, les avait rendus encore plus incertains, et bien des femmes, bien des enfants avaient péri de cette horrible manière.
Quelques-uns respiraient encore quand nous arrivâmes ; quelques-uns aussi, mais plus rares, étaient arrivés, comme par miracle, saints et saufs sur le sommet aplati de rochers qui ne communiquaient à rien. - On fit la chaîne, on se servit de cordes pour les tirer de là, et la crainte qu'ils avaient de nous était le plus grand obstacle apporté à leur délivrance.
L'aspect de la place de la Casbah offrait le tableau militaire le plus varié et le plus curieux ; les soldats privés de tout depuis longtemps, se retrouvaient dans l'abondance, et s'empressaient de réparer la diète qu'ils avaient été obligés de faire. Les uns arrivaient chargés de galettes maures,les autres de pots de beurre, beaucoup de viande conservée ; on se réunissait, on cuisinait, et bien des feux s'élevaient dans les angles de la place, et sur le plateau dominant le ravin.
Je ne veux pas parler des bazards qui s'organisaient à côtés des cuisines, mais j'ai remarqué que les bons soldats n'avaient pris que des vivres ; les mauvais venaient chargés de tapis, de burnous, de grandes couvertures, de haïcks ; que sais-je, tout était pillé, rien n'était respecté. Des soldats ont trouvé des coffres plein d'argent. Il en est qui ont rapporté plusieurs mille francs en monnaie du pays.
Le camp offrit pendant plusieurs jours l'aspect d'un vrai marché. Des juifs y abondaient. Ils venaient pour tromper le soldat, et plusieurs d'entre eux furent pris eux-même pour dupes. On avait trouvé dans les maisons beaucoup de petites pièces jaunes imitant parfaitement l'or ; les juifs qui avaient suivi l'armée les prirent pour des roubles turcs valant 2 francs 50 centimes, et les payaient aux soldats jusqu'à 2 francs. Ces pièces n'avaient aucune valeur, c'était du cuivre, les Maures ne s'en servait que comme des jetons pour jouer.
Cependant, on cherchait à arrêter le désordre et le pillage. Le général Rulhières fut nommé gouverneur de Constantine, le chef de bataillon Bedeau, commandant de la place ; les ordres les plus sévères furent donnés. Le 47ème de ligne, le 2ème léger, les zouaves entrèrent en ville, le 13 et le 14 ; on logea les soldats dans les plus grandes maisons dont on fit des casernes. Les officiers s'emparaient des maisons vides voisines des caserne de leur régiment. Le logement ne manquait pas, car toutes les belles maisons étaient vacantes et abandonnées. Tout ce qu'il y avait de plus riche à Constantine était parti pendant le siège. Il ne restait plus dans la ville que les Turcs, les Kabyles, et la partie combattante. Les citoyens restés ne se composaient que de Juifs, de vieillards et de pauvres gens.
Quand l'état-major nombreux de tous les corps spéciaux, l'intendance, l'administration, eurent choisi les plus beaux logements, il en restait encore assez pour loger la véritable armée, l'armée combattante et souffrante.
Le soir de la journée du 13, nous retournâmes dans nos position sur le Coudiat-Aty, ce ne fût que le 16 que nous reçûmes l'ordre d'entrer en ville.
Pendant ce temps, le commandant de la place, quoiqu'entravé à chaque instant dans ses bonnes intentions, prit les mesures les plus sages et les plus à propos. Tous les Juifs, convoqués par leur roi, d'après les ordres du commandant Bedeau, furent occupés pendant trois jours à enlever les morts de toute nation, et à les enterrer dans un immense trou creusé près de la ville. Le nombre des morts surpasse toute prévisions, puisque le trou ne suffit pas, les cadavres entassés ne sont pas enterrés assez profondément ; trop peu de terre les recouvre, et Constantine pourra bien ressentir de cet inconvénient, quand arriveront les chaleurs.
Pendant bien des jours on trouvait des cadavres dans des maisons abandonnées. Les Juifs appelés les portaient hors de la ville, où des trous les recevaient.
C'était un affreux spectacle que de voir le lendemain et le surlendemain de l'assaut, au bas de la brèche, les morts des deux nations, étendus séparémént, attendre une sépulture commune. Parmi nos soldats, nous reconnaissions bien des braves qui méritaient un meilleur sort. Le nombre s'élevait à environ 150. Les Arabes, beaucoup plus nombreux, se comptaient par cinq cents. On pouvait reconnaître aux blessures et à l'âge de quelques-uns toutes les horreurs d'un assaut.
Les Juifs furent aussi employés à nettoyer la ville qui en avait le plus gransd besoin. Cette opération eut été beaucoup plus prompte si on avait eu des ânes en plus grand nombre pour transporter les immondiices ; mais quoique Constantine, comme toutes les villes arabes, en fût abondamment pourvue, on n'en trouvait que peu ; les soldats les avaient tous pris.
Le 16, nous entrâmes dans Constantine pour y tenir garnison. Notre pauvre bataillon décimé par les balles les fièvres et déjà le choléra, fut caserné dans une petite et sale impasse où il occupait trois maisons. Nous logions autour de ce cloaque. J'avais pour moi seul une vaste et belle maison où je faisais, par précaution, loger quelques soldats. Deux de nos officiers avaient failli être assassinés par des Kabyles dans leur maison.
Les boutiques rouvraient peu à peu, la confiance revenait, mais lentement. Les Arabes n'apportaient que peu de choses au marché et faisaient tout payer au poids de l'or. On fut obligé de taxer les denrées.
Du reste l'aspect de la ville était sombre. Les Juifs se promenaient en grand nombre avec leur servilité riante et abjecte ; mais les habitants, tristes, mornes, souffraient ce qu'il ne pouvait empêcher. Leurs regards, quelquefois menaçants, témoignaient de leur peu de bienveillance. Comment ces gens-là pourront-ils oublier jamais le sac de leurs maisons et leur ruine pour bien des années ?
Les régiments évacuaient par convois ; le choléra encombrait les hôpitaux ; harassés par une fatigante victoire, officiers et soldats regardaient comme heureux ceux qui allaient retrouver leur vie de camp, devenue bonne par comparaison, et les partants pour Bône étaient enviés. Après bien des indécisions, des ordres et des contre-ordres, car tout le monde voulait gardes hommes qui s'étaient fait une si belle réputation, nous reçumes enfin l'ordre formel de partir le 29. Nous avions l'honneur de faire partie de la brigade du prince, et nous étions le dernier convoi qui dût quitter Constantine, où restaient environ trois milles honne, sous les ordres du Général Bernelle.
Ceux qui, tranquillement assis sur leur banquette rembourrée, les pieds chauds et l'estomac plein, vont décider par caprice ou par passion si l'on gardera ou non cette conquête, ne se doutent guère de ce qu'elle a coûté.
<ret>Revenir</ret>